
Un monde caché
La Conversation On discute champignons et épanouissement mutuel avec deux écrivaines
PAR: SARA BARON-GOODMAN
ILLUSTRATION PAR : JASON LOGAN
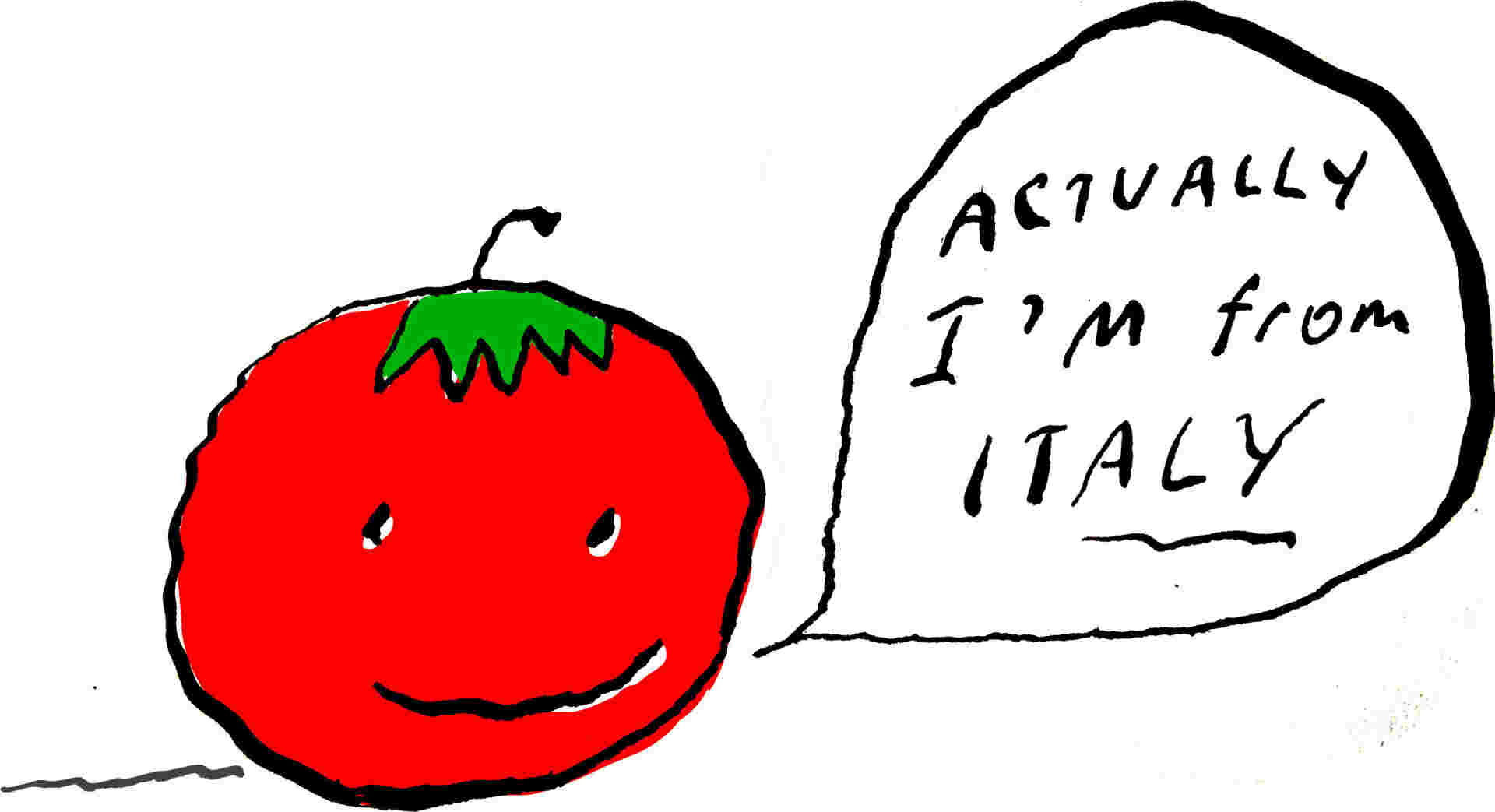
Je réalise qu’ici, en Amérique du Nord, on ne voit jamais d’arbres fruitiers en ville. J’ai grandi à Montréal, où il fallait s’éloigner du centre pour faire son autocueillette. On partait chez un producteur dans les Cantons de l’Est ou dans les Laurentides pour y remplir notre panier de pommes ou de bleuets. Ce privilège était payant et l’expérience s’apparentait quelque peu à une sortie scolaire, où on apprend aux enfants que les fruits ne poussent pas à l’épicerie.
Ces 15 derniers mois, j’ai vécu en Italie. Au pied des Alpes, dans un petit village du Piémont perdu au milieu des champs, j’ai fréquenté une université qui faisait l’éloge des systèmes alimentaires durables et de l’écogastronomie. Manger local ne relève pas vraiment de l’exploit quand la terre est fertile à l’année et que tout le monde ou presque a des vignes, un verger, un potager, quelques poules et un ou deux cochons. Même à Rome, les orangers, oliviers, câpriers et châtaigniers, accompagnés de romarin, poussent dans les parcs, au bord des trottoirs, le long des autoroutes. C’est le paradis du cueilleur urbain, avec des fruits mûrs prêts à lui tomber dans la main.
Je souhaitais sortir de cette formation culinaire avec une bonne idée de ce qu’était l’écoalimentation, capable de transposer l’idéalisme de la tradition gastronomique italienne dans un milieu urbain nord-américain. J’en suis repartie avec encore plus de questions.
Dans nos villes, se nourrir en fonction de notre climat, comme les peuples autochtones l’ont fait, n’est plus qu’un lointain souvenir, effacé par quelques siècles de colonialisme et une bonne louche de capitalisme post-industriel. La solution est-elle de redevenir locavore? Pas forcément. Il faut d’abord tenir compte de la réalité quotidienne de l’Homo urbanus qui, n’ayant pas accès à des hectares de terre fertile, dépend de la fruiterie du coin. Et puis, qui dit métropole dit multiculturalisme et le besoin pour les communautés de trouver les ingrédients propres à leur cuisine (essayez donc de dénicher un piment jalapeno au Piémont. C’est aussi simple que le dédale de la bureaucratie italienne!). Enfin, il y a la météo, hostile huit mois de l’année.
Le vrai développement durable, c’est celui qui met l’alimentation en lien avec les saisons tout en étant écoresponsable et socioresponsable économiquement et culturellement. Il n’y a pas de solution facile, mais, je crois que si, dans nos grandes villes canadiennes, on plantait quelques fines herbes sur le bord de notre fenêtre ou on trouvait le moyen d’utiliser un poulet en entier sans rien jeter, on ferait un pas dans la bonne direction. Pour manger proprement, on doit commencer par se salir un peu les mains.